Les Jeux Olympiques d’hiver ne sont pas seulement un événement sportif, ils transforment l’image et l’attractivité des régions qui les accueillent.
À travers les exemples de Grenoble 1968, d’Albertville 1992 et les Jeux à venir en 2030, voyons comment ces événements ont façonné le tourisme en montagne.
Grenoble 1968
Avant 1968, Grenoble était une ville de passage vers les stations alpines. Les JO ont marqué un tournant en mettant la région sous les projecteurs internationaux. En cinq ans, le nombre de nuitées touristiques a augmenter de 30 %, atteignant le nombres de 2 millions en 1970. Chamrousse, station clé des épreuves de ski, a vu sa fréquentation exploser avec une hausse de 60 %.

Grâce à cette mise en lumière, Grenoble a affirmer son statut de “capitale des Alpes”, devenant la porte d’entrée vers les stations de ski. Les investissements hôteliers ont augmenté de 40 %, avec de nouvelles infrastructures ou encore des offres de séjours pour accueillir les visiteurs.
Les défis post-JO
Cependant, après les Jeux, certaines infrastructures ont été sous-exploitées et le développement rapide a dépassé la demande. Plusieurs stations ont eu du mal à fidéliser la clientèle étrangère, laissant tomber en ruine certains installations. En cinq ans, la consommation énergétique des stations olympiques a augmenté de 25 %.

Albertville 1992
Les JO d’Albertville ont marqué un tournant en favorisant le tourisme international. Dès l’hiver suivant, les réservations ont augmenté de 20 %, et la clientèle étrangère à augmenté de 35 % en trois ans. Des stations comme Courchevel et Val d’Isère ont bénéficié d’une notoriété mondiale, renforçant leur attractivité.
Albertville 1992 a aussi contribué au développement d’un tourisme sur les quatre saisons. La diversification des activités (randonnée, VTT, pour les sports d’été) a permis une augmentation de 50 % des nuitées estivales entre 1990 et 1995, réduisant la dépendance à la neige.

Les limites
Certaines infrastructures, comme la patinoire d’Albertville, ont eu du mal à être rentabilisées après les Jeux. Par ailleurs, l’intensification du tourisme a accentué la pression sur les ressources naturelles. Entre 1992 et 2000, la production de neige artificielle a nécessité 30 % de prélèvements en eau supplémentaires, soulevant des problématiques environnementales et de surfréquentation.
Les JO de 2030

Les Jeux de 2030 ont pour ambitions d’éviter les erreurs du passé en misant sur un tourisme plus responsable. On privilégie alors la réutilisation des infrastructures et les transports écologiques. L’objectif, augmenter la fréquentation hivernale de 15 % tout en réduisant de 40 % l’empreinte carbone.
Les actions qui vont êtres mises en places :
- Réduction des hébergements énergivores,
- Développement des navettes électriques gratuites pour limiter la voiture individuelle,
- Développement des activités hors ski (ex : randonnée hivernale).
Depuis 20 ans, les stations alpines ont déjà perdu 25 % de leur durée d’ouverture à cause du réchauffement climatique, d’où l’urgence d’adapter l’offre.

Les JO d’hiver ont profondément marqué le tourisme alpin. Grenoble 1968 a initié la transformation, Albertville 1992 a renforcé l’attractivité des stations, et 2030 tentera d’allier un équilibre économique écologique. Si ces événements ont boosté le secteur, ils ont aussi soulevé des problématiques de gestion des infrastructures et d’impact environnemental. Reste à voir si les JO de 2030 sauront réinventer un tourisme plus équilibré et durable.
Nos réseaux sociaux:
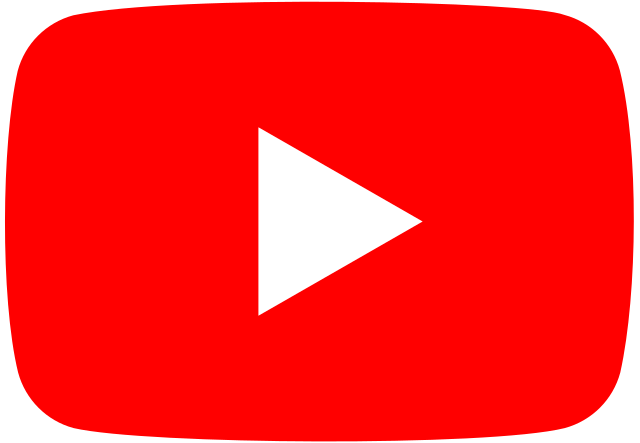

Écrit par Tiphaine CHALAMET
Si cette article t’intéresse, alors retrouve nous le 2 avril 2025, à l’UFR Staps de Grenoble, pour en apprendre d’avantages!

